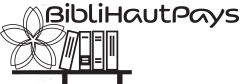Gabriele d’Annunzio est né en Italie en 1863, Thomas Mann en Allemagne en 1875. Le roman paraît en 1900, la nouvelle en 1912. C’est dire qu’à travers des personnalités et des styles très différents, ils sont représentatifs de toutes les affres et toutes les interrogations de la fin du XIXè siècle et du début du XXè. Les deux œuvres constituent des parcours initiatiques aboutissant à une épiphanie, au sens ancien de compréhension soudaine de l'essence ou de la signification de quelque chose. Elles ont une tragique et surprenante ressemblance.
Aucune de ces oeuvres n’est facile.
Dans « Le Feu », Stelio, poète, auteur tragique et musicien mais aussi jeune homme à la mode, et La Foscarina, « l’Enchanteresse », actrice au sommet de la célébrité et de sa beauté, vivent un amour brûlant fait d’une grande fascination de part et d’autre. Bien qu’elle n’ait vraisemblablement que quatre ou cinq années de plus que son amant, cette très belle femme est minée par la menace que le temps fait peser sur elle et sur leur passion. Leur rencontre d’une fort jolie et talentueuse cantatrice, Donatella, encore très jeune, la fait plonger dans le désespoir et plutôt que de voir l’Aimé se séparer d’elle - ce que lui, de son côté, n’envisage pas -, elle va s’arracher à lui et à Venise pour aller aussi loin qu’elle pourra, de l’autre côté de l’océan.
Gabriele d’Annunzio s’abandonne à tous les excès de son style flamboyant. Nourries des chefs d’œuvre antiques et modernes, ces pages lyriques font davantage penser à un opéra italien chanté qu’à une oeuvre écrite. Les duos d’amour y sont bouleversants, les introspections sublimes de clarté et de profondeur, la trame symbolique serrée et portée par un souffle théâtral. Ce qui n’empêche pas l’auteur de se pencher avec délicatesse sur une fleur, une grenade mûre, un beau chien. On n’a plus du tout l’habitude aujourd’hui d’un tel triomphe de la langue -et encore n’avons-nous lu que la traduction (mais de Georges Hérelle, quand même).
Dans « La mort à Venise », Gustav von Aschenbach, écrivain veuf et solitaire, de santé fragile, a brusquement décidé de quitter Munich et pose ses valises à Venise, qui l'a toujours séduit, bien qu'il n'en ait jamais supporté le climat. Il espère y retrouver « l’élan du mécanisme créateur », sa vigueur physique comme littéraire. Dès sa première journée à l’Hôtel des bains du Lido, établissement de luxe à la clientèle cosmopolite, lui apparaît un jeune garçon d'une beauté si « prodigieuse » qu'il en reste « confondu ». Tadzio est d’une famille patricienne polonaise qui, dans ce milieu un peu vulgaire, tranche par son extrême réserve et une rare et fastueuse élégance. L’écrivain, fasciné par cette perfection pré-pubère un peu androgyne, se grise à la contempler - de loin -, et se réjouit du renouveau qu’elle opère sur son esprit, son humeur et sa créativité. Mais cet adepte d'une vie de rigueur et de travail glisse de jour en jour vers un état amoureux qui suscite en lui émerveillement et honte. La chaleur étouffante, qui déjà l’accable, se double de la menace d’une épidémie de choléra dans la Ville, qu’on essaie de cacher à la riche clientèle étrangère. Aschenbach ne peut se résoudre à quitter Venise et se laisse emporter par une idolâtrie grinçante qui lui fait oublier sa si chère « dignité ». Dans les dernières pages, alors que fuient tous ceux qui savent, il cède à la tentation de grimer sa réalité d’homme vieillissant, « ses cheveux gris, son visage fatigué, ses traits durs » et s’abaisse, à travers des « ruelles pauvres », « où rôdait, masquée, l’abjecte mort », à un harcèlement dégradant pour lui-même et l’enfant qu’il poursuit. Ses forces déjà chancelantes s’épuisent dans cette obsession et la mort le saisit sur une plage désertée, dans l’éblouissement d’une silhouette en contre-jour, qui, peut-être, lui a fait signe.
Thomas Mann voulait faire de cette œuvre sa « production la plus valable dans le domaine de la nouvelle ». L'application et une rigueur toute germanique y déroulent un style dense aux phrases interminables, que les traductions que nous avons eues en main n’améliorent pas. Mais il passe dans cette nouvelle, par la grâce de Venise sans doute et du parrainage muet des antiques, un rythme souple et plus léger que de coutume. Sa vision a tout un arrière-plan mythologique et artistique : tout cela « faisait songer à la statuaire grecque de la plus belle époque ».
Les deux œuvres comportent un travail très fin sur l’Art, la création littéraire, les exigences de l’écriture et l’échange parfois délétère entre l’écrivain et le personnage qu’il a créé.
« D'être seul et de se taire, on voit les choses autrement qu'en société ; en même temps qu'elles gardent plus de flou, elles frappent davantage l'esprit ; les pensées en deviennent plus graves, elles tendent à se déformer et toujours se teintent de mélancolie. Ce que vous voyez, ce que vous percevez, ce dont en société vous vous seriez débarrassé en échangeant un regard, un rire, un jugement, vous occupe plus qu'il ne convient, et par le silence s'approfondit, prend de la signification, devient événement, aventure, émotion. De la solitude naît l'originalité, la beauté en ce qu'elle a d'osé, et d'étrange, le poème ».
« [L]a passion, comme le crime, ne s'accommode pas de l'ordre normal, du bien-être monotone de la vie journalière, (...) elle doit accueillir avec plaisir tout dérangement du mécanisme social, tout bouleversement ou fléau affligeant le monde, parce qu'elle peut avoir le vague espoir d'y trouver son avantage ».
« Qui pourrait déchiffrer l’essence et l’empreinte spéciale d’une âme d’artiste? Comment analyser le profond amalgame du double instinct de discipline et de licence dont sa vocation se compose ! ».
« La pensée qui peut, tout entière, devenir sentiment, le sentiment qui, tout entier, peut devenir pensée, font le bonheur de l'écrivain. L'idée envahissant le cœur, le sentiment monté au cerveau, qui appartenaient et obéissaient à ce moment-là au rêveur solitaire, étaient tels : il savait, il sentait que la nature frissonne de délices quand l'esprit s'incline en vassal devant la beauté. Il fut pris soudain du désir d'écrire. » (Mann)
Une méditation sur l’Amour, la Beauté, la Mort
Venise, ville mythique, cité-reine, est elle-même l’incarnation de cette méditation et lui donne son cadre somptueux :
« Connaissez-vous (…) au monde un autre lieu qui possède autant que Venise, à certaines heures, la vertu de stimuler l’énergie de la vie humaine par l’exaltation de tous les désirs jusqu’à la fièvre ? Connaissez-vous une plus redoutable tentatrice ? » (d’Annunzio).
« La ville à qui de tels créateurs ont composé une âme d’une telle puissance, (…) la plupart ne la considèrent aujourd’hui que comme un grand reliquaire inerte ou comme un asile de paix et d’oubli ! (…) Ah ! si je savais dire de quelle vie prodigieuse elle palpite dans ses mille ceintures vertes et sous ses immenses colliers ! Il n’est pas de jour où elle n’absorbe notre âme ; et tantôt elle nous la rend intacte et fraîche et toute neuve, d’une nouveauté originelle où demain l’empreinte des choses aura une netteté indicible ; et tantôt elle nous la rend infiniment subtile et vorace, comme une flamme qui détruit tout ce qu’elle touche, de sorte que, le soir, parmi les cendres et les scories, nous retrouvons parfois quelque sublimation extraordinaire. Chaque jour elle nous invite à l’acte qui est la destinée même de notre espèce : l’effort sans trêve pour se surpasser soi-même ; elle nous montre la possibilité d’une douleur qui se transforme en la plus efficace énergie stimulante ; elle nous enseigne que le plaisir est le moyen le plus certain de connaissance que nous ait départi la Nature et que l’homme qui a beaucoup souffert est moins sage que l’homme qui a beaucoup joui. » (d’Annunzio).
Se confronter à la pure Beauté, « la seule idée qui se puisse contempler » (Mann), amène fatalement à l'idée de la Mort. Si l’Amour est « Le Feu » qui éclaire la vie et lui donne son sens, il est aussi celui qui la détruit, d’autant que, dans les deux oeuvres, l’amour est interdit, par l’âge et les règles sociales tels que les ressentent les protagonistes.
« L'histoire est essentiellement une histoire de mort, mort considérée comme une force de séduction et d'immortalité, une histoire sur le désir de la mort. Cependant le problème qui m'intéressait surtout était celui de l'ambiguïté de l'artiste, la tragédie de la maîtrise de son Art. La passion comme désordre et dégradation était le vrai sujet de ma fiction.
Ce que je voulais raconter à l'origine n'avait rien d'homosexuel ; c'était l'histoire du dernier amour de Goethe à soixante-dix ans, pour Ulrike von Levetzow, une jeune fille de Marienbad : une histoire méchante, belle, grotesque, dérangeante qui est devenue La Mort à Venise. À cela s'est ajoutée l'expérience de ce voyage lyrique et personnel qui m'a décidé à pousser les choses à l'extrême en introduisant le thème de l'amour interdit. Le fait érotique est ici une aventure anti-bourgeoise, à la fois sensuelle et spirituelle » (Mann).
« (…) (il) est parvenu au milieu de son existence mortelle, déjà loin de sa jeunesse, déjà près de son déclin ; et voilà qu’alors seulement la vie se révèle à lui riche de tous les biens, telle une forêt chargée de fruits vermeils, dont ses mains occupées ailleurs ne connurent jamais le frais velours .(…) il souffre d’une confuse angoisse où le regret domine le désir, tandis que, sur la trame des harmonies qu’il recherche, la vision de son passé, -ainsi qu’il aurait pu être et qu’il ne fut pas,- se compose comme un tissu de chimères. (…) Mais là se trouve aussi, émergeant de l’ombre chaude comme l’expression même du désir, le jeune homme au chapeau empanaché et à la longue chevelure : ardente fleur d’adolescence (…) reflet de ce mythe hellénique d’où naquit la forme idéale d’Hermaphrodite. Il est là, présent mais étranger, séparé des (autres) comme un être qui n’a souci que de son propre bien. La musique exalte son indicible rêve et semble multiplier indéfiniment sa faculté de jouir. (…) Son regard est oblique et intense, détourné vers un certain point comme pour y séduire je ne sais quoi qui le séduirait ; sa bouche close est comme une bouche déjà lourde d’un baiser non donné encore ».
Voilà une belle description d’Aschenbach et de Tadzio, penserez-vous. Pas du tout, c’est une page de d’Annunzio…
Les convenances de l’époque ne permettent aucun contact, aucun échange, même une conversation anodine, entre personnes qui n’ont pas été présentées officiellement, à plus forte raison entre un garçonnet, sous la surveillance de sa mère et de sa gouvernante, et un homme seul et déjà âgé. « Il n'est rien de plus singulier, de plus embarrassant que la situation réciproque de personnes qui se connaissent seulement de vue, qui à toute heure du jour se rencontrent, s'observent et qui sont contraintes néanmoins par l'empire des usages ou leur propre humeur à affecter l'indifférence et à se croiser comme des étrangers, sans un salut, sans un mot » (Mann).
Rien n’est dit dans la nouvelle de Mann des sentiments ni des pensées de Tadzio, présenté comme un être solaire mais frêle, fragile et peut-être même malade. Le jeune garçon ne montre que par ses regards et ses mouvements de tête qu’il se sait observé. Mais ne ressemble-t-il pas à un oiseau fasciné ? Ne pourrait-on lui appliquer ce passage du « Feu » sur La Foscarina ?
« Une fois de plus, elle éprouvait une inquiétude et une crainte qu’elle-même ne savait pas définir. Il lui semblait qu’elle perdait le sentiment de sa vie propre et qu’elle se trouvait transportée dans une sorte de vie fictive, intense et hallucinante, où sa respiration devenait difficile. Attirée dans cette atmosphère aussi ardente que le foyer d’une forge, elle se sentait capable de toutes les transfigurations qu’il plairait à l’animateur d’opérer sur elle pour satisfaire son continuel besoin de beauté et de poésie. » (d’Annunzio).
« A Venise, de même qu’il est impossible de sentir autrement que selon des modes musicaux, de même il est impossible de penser autrement que par images. » (d’Annunzio)
Quand Thomas Mann écrit cette nouvelle en mai-juin 1911, de ce même hôtel du Lido où il séjourne, il vient d’apprendre que son grand ami Gustav Malher vient de mourir.
« Aschenbach a l'apparence physique de Gustav Mahler, le grand musicien autrichien, qui venait juste de rentrer gravement malade d'une tournée de concerts en Amérique ; et son agonie princière à Paris et à Vienne, telle qu'on la vécut jour après jour dans les bulletins de presse quotidiens, me décida à prêter à mon héros la rigueur passionnée du personnage d'artiste qui m'était familier. »
C’est donc à bon droit que le film de Visconti « Mort à Venise » se déroule sur le fond de la cinquième symphonie de Mahler.
Mais c'est aussi à Venise qu'est mort, en 1883, Richard Wagner, à qui Mann dédie un essai durant la même période.
Or, c’est « Le Feu » de d’Annunzio qui finit en apothéose par les funérailles de Wagner, le « Héros », « élu de la Vie et de la Mort », emporté dans un cercueil de cristal et de métal poli, sur les épaules de six robustes compagnons, « vers la colline bavaroise encore endormie sous le gel ».
La Mort s’annonce de très loin par des signes et des épisodes fulgurants qui plongent les personnages dans un malaise qu’ils ne s’expliquent pas.
Dans « Le Feu », ce sont deux figures de femmes qui parlent de la fuite du temps : Radiana de Glanegg, comtesse viennoise, qui dès les premiers signes du flétrissement de sa beauté, s’est enfermée dans son palais, sans miroirs ni témoins : « Derrière ces murailles, une âme désolée survit à la beauté d’un corps ». Et l’allègre et désespérée Lady Myrta, qui en vraie Vénitienne, cache les ravages du temps derrière des fards et des fêtes. Deux lieux préfigurent la disparition de l’amour et de la vie : dans un jardin, le labyrinthe aux « inextricables détours » où le jeu tourne vite à l’angoisse chez elle, à la perversité chez lui et à Murano, une verrerie où le feu détruit ce qui existe, donnant naissance à d’autres formes, « sublimées ».
Dans « La mort à Venise », ce sont des rencontres, inexpliquées, déstabilisantes qui mettent d’Aschenbach en face de son Destin : un randonneur, comme surgi d’un cimetière voisin, va le jeter dans une inquiétude singulière, « (…) une envie de voyages ; mais qui le prenait aussi brusquement qu’une crise, une passion presque, et jusqu’à l’hallucination poussée ». Tel Charon, un batelier inquiétant l’emporte sans paroles sur la lagune. Une petite troupe de bateleurs vient distraire les clients dans les jardins de l’hôtel ; parmi eux, un comédien au comportement « équivoque et vaguement répugnant » provoque une « ambiance louche », presque menaçante. Curieusement, ces trois personnages sont roux, couleur considérée comme maléfique, couleur des sorciers. L’allégorie la plus évidente, la plus dérangeante est celle du « vieux beau », rencontré sur le bateau en compagnie d’un groupe de jeunes gens ivres, parodie affreuse et bouffonne de la jeunesse, image de la décrépitude maquillée qui semble tendre un miroir à l’écrivain pour qu’il y voie son propre avenir.
L’épisode le plus atroce, et qui va être le déclencheur du dénouement, est certainement l’espèce de Danse macabre à laquelle se livrent les bateleurs avant de s’enfuir, cette chanson incompréhensible mais qu’on devine effrontée, ce rire offensant, ce « ricanement sardonique », comme si ces gueux, qui savent qu’on meurt en ville, se réjouissaient de la mort prochaine des hôtes étrangers que tous gardent dans l’ignorance du danger. Aschenbach ressent la scène « comme un cauchemar, un charme qui tenait liés sa tête et son esprit de liens indéchirables et qu’il était impossible de fuir ». Mais comme si une flèche maléfique s’était plantée en lui, sa première pensée basse lui vient à entendre la respiration embarrassée de Tadzio. Une « satisfaction perverse » envahit son cœur. L’Aimé aussi est mortel…
Mais rien ne peut plus empêcher la course de la fatalité, même la conscience vague d’être en proie au Destin : « Ce qui était si pénible à admettre, ce qui par moment lui paraissait absolument intolérable, c'était manifestement la pensée qu'il ne devait jamais revoir Venise et que ce départ était un adieu définitif ». De même que l’arrachement de La Foscarina aux bras de Stelio est mortel et sans retour, la splendide scène finale de la nouvelle de Mann est quasiment sépulcrale. La silhouette de Tadzio noyée dans la lumière, sur son banc de sable loin du rivage, pourrait aussi bien être de celles qui figurent en marbre sur les tombes.
« Le repos dans la perfection, c'est le rêve de celui qui peine pour atteindre l'excellence ; et le
néant n'est-il pas une forme de la perfection ? » (Mann).