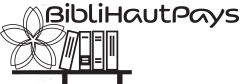Nels Anderson a fait paraître aux USA en 1923 : « Le Hobo : sociologie du sans-abri ».
Il n’a pas fallu moins de soixante-dix ans pour cette monographie célèbre en matière de sociologie urbaine empirique traverse l’Atlantique et soit publiée chez Nathan en 1993. L’ouvrage est accompagné d’une préface d’Anne Marie Arborio et Pierre Fournier sur l’intérêt actuel du livre et complété d’une autobiographie rédigée par l’auteur pour la réédition de 1961. Il a été enrichi en 2011 d’une postface d’Olivier Schwartz – rapidement érigée, elle aussi, au rang de « classique » – intitulée « L’empirisme irréductible », très documentée, qui ne passionnera pas seulement ceux qui s’intéressent à la méthodologie et aux difficultés de la démarche ethnographique.
Cette étude du prolétariat hobo est en fait le mémoire de maîtrise en sociologie de Nels. Elle entre dans une continuité familiale : son père, venu de Suède, avait occupé toutes sortes d’emplois ouvriers, devenant lui-même un hobo, avant de se stabiliser avec sa famille. Quant à Nels, il quitte prématurément l’école et appartient à ce milieu pendant plusieurs années.
Un peu d’histoire
La « conquête de l’Ouest » au XIXè siècle en Amérique du Nord, après l’achat de la Louisiane en 1803, s’est effectuée en deux vagues : la première, celle des pionniers, qui, après les trappeurs, les aventuriers et quelques expéditions militaires et explorations scientifiques, se lancent à l’assaut d’une « terre promise » qu’on leur a garantie vacante et qu’ils ressentent comme telle. Agriculteurs, artisans, petits boutiquiers d’origine essentiellement européenne, ils s’aventurent en famille dans cet immense territoire qui s’étend entre le Mississippi et l’océan Pacifique. La zone de cette colonisation aux allures d’épopée sanglante est appelée par les américains la « première frontière » (Frontier signifie les confins). Après la guerre civile, la seconde vague est celle de l’expansion industrielle, avec l’achèvement en 1869 de la première ligne de chemin de fer transcontinentale. C’est la « seconde frontière » dont Anderson étudie ceux qui en sont pour lui les « héros » : les ouvriers migrants qui, de 1865, date de la fin de la guerre de Sécession, jusqu’à la crise de 1929, furent aux yeux de l’auteur les bâtisseurs de l’Amérique moderne.
La « seconde conquête de l’Ouest » s’est effectuée sur des territoires où n’existait aucune réserve de main d’œuvre. L’expansion économique « exigeait des populations ouvrières mobiles, capables de se déplacer sur de longues distances pour occuper des emplois intermittents, de circuler entre des tâches différentes et des sites souvent très éloignés les uns des autres, et de supporter des modes de vie fondés sur l’alternance de périodes de travail et de chômage ». De ce fait, « le phénomène Hobo s’est d’abord développé comme une tentative d’adaptation ouvrière aux caractéristiques générales de l’économie dans l’Ouest » (post-face d’Olivier Schwartz).
Industrialisation, mobilité et travail précaire sont des thèmes liés.
On en a déjà vu un exemple dans Germinal d’Emile Zola avec le personnage d’Etienne Lantier « ouvrier sans travail et sans gîte » « perdu sur les routes ». La question des ouvriers migrants sans emploi fixe existe dans d’autres contextes du début du XXè américain ou européen. On peut citer Jack London (USA)(1876-1916). Ses périodes de vagabondage se situent en 1894, puis en 1898-99, sans parler de son expérience nautique de sept ans dans le Pacifique. Il fait paraître « Le peuple de l’abîme (Londres) » en 1903 et « Les vagabonds du rail (USA) » ( The road ) en 1907. Ainsi que George Orwell (GB)(1903-1950). Sa période de vagabondage ouvrier dure de 1927 à 1929, sans parler de son enquête sur le prolétariat des régions minières anglaises ni de son aventure pendant la guerre d’Espagne. Il publie « Dans la dèche à Paris et à Londres » en 1933 (Down and Out in Paris and London) (traduit en français en 1935 sous le titre « La vache enragée »).
Le hobo est une figure particulière de cette précarité et l’image d’une « époque dans l’histoire de la classe ouvrière américaine ».
« Il n’est de hobo qu’américain » ( Nels Anderson : autobiographie).
LE « HOBO »
« Hobo » pourrait se traduire en français par « vagabond », « chemineau » (à ne pas confondre avec cheminot, qui désigne l’employé du chemin de fer) et plus précisément "trimardeur". Mais cette réalité est sans véritable équivalent dans la culture française. Son étymologie n'est pas certaine. La plus probable est la contraction de « homeless boy » (garçon sans maison) par opposition avec « homeless men », qui désigne les clochards sédentaires et privés de travail.
En 1873, lors de la grande dépression, plus de 3 millions d'individus se retrouvent au chômage. Grâce à plus de 400 000 km de voies ferrées, les « hobos », comme ils se dénomment eux-mêmes, vont initier une variante originale du vagabondage :
le vagabondage ferroviaire
L'image du hobo est en effet inséparable de celle du train. Les hobos fournissent une main-d’œuvre saisonnière dans l’agriculture, le découpage de la glace et l’abattage des forêts mais travaillent surtout sur les chantiers de construction temporaires et en particulier ceux du chemin de fer. Ils se déplacent en permanence d’un endroit à l’autre au gré des opportunités d’embauche, empruntant clandestinement les wagons des trains de marchandises, pratique appelée « brûler le dur » (ride freight trains).
Ces hommes travaillent l'été à l'Ouest, au gré de leurs déplacements, et l’hiver regagnent les grandes villes de l'Est, notamment Chicago. Chicago est déjà à l’époque une énorme métropole qui compte 2M d’habitants en 1900 et dépasse les 3M en 1930. Important noeud ferroviaire, elle est la plaque tournante entre l’Est et l’Ouest. Les hobos y trouvent un marché du travail (bureaux de placement) et un lieu de vie où on peut se loger, se nourrir, se soigner et se distraire mais aussi « un espace de contacts, de socialisation et de culture » : les ouvriers migrants décrits par Anderson sont des ouvriers urbanisés qui sont pour la plupart anglophones et possèdent un minimum d’instruction.
Des points d'accueil plus ou moins improvisés, à l’existence plus ou moins longue, existent le long des principales lignes de chemin de fer. On en a vu un exemple dans le roman « Des beignets de tomates vertes ». Le café-gargotte d’Idgie et Ruth justement dénommé « Whistle Stop cafe » est installé près de la voie ferrée. On y voit passer « Smockey », personnage de hobo déjà âgé, dont le surnom même est révélateur (enfumé). Cette présence du chemin de fer joue un grand rôle symbolique et rappelle que le rail tue et estropie. Il s’agit sans nul doute d’un clin d’œil de Fannie Flagg que le public américain a facilement identifié mais qui a pu échapper complètement à un lecteur européen.
Dans ces endroits, les migrants peuvent demander où trouver de l'emploi et se stabiliser quelques semaines ou quelques mois. Ces informations peuvent également être transmises par des symboles dessinés à la craie ou au charbon sur les murs des immeubles en ville, sur des ponts ou des poteaux en campagne. Ce système, appelé en France "langue des trimardeurs", est précieux pour donner des avertissements pratiques (endroits pour attraper un train, pour dormir, présence fréquente de la police, possibilité de repas chauds, chiens dangereux, etc.).
Les signes
« Hobo signs » « The American Hoboes, Riders of the Rails » de Fran DeLorenzo.
Destin , hasard, nécessité ?
Il est certain que le nomadisme hobo s’expliquait moins par le vertige du voyage que par les sursauts d’un système économique sauvage, caractérisé par un niveau élevé de chômage et d’irrégularité du travail. Il est non moins certain que ces hommes étaient des rebelles, épris de liberté et que, chez certains, la migration avait pris « la coloration d’un romantisme de l’aventure et du défi à l’ordre établi » (post-face).
Toutefois, la tentation était grande de relever dans leur comportement une certaine pathologie de l’errance chronique, ou « dromomanie », tentation à laquelle ont cédé nombre de philanthropes et associations caritatives, missions et organisations d’aide sociale ainsi que les services officiels, en particulier la police publique et la police privée du rail, particulièrement dure pour les passagers clandestins et les pillards.
Nels Anderson insiste beaucoup sur le fait que la catégorie de « hobo » ne recouvre pas l’ensemble de ceux que l’on qualifierait de « sans-abri ». Le hobo est sans domicile mais il est un travailleur et il est mobile. Il n’est ni un vagabond, qui ne travaille pas, ni un « casanier » (home guard) qui travaille mais n’est pas mobile, ni un clochard, qui ne se déplace pas.
Il est indiscutable que tout hobo, potentiellement et souvent réellement, fait partie des sans-abri mais il ne s’y réduit pas. Ceux que Anderson connaît et étudie forment très précisément un ensemble de travailleurs journaliers – jeunes Américains célibataires, alphabétisés et « urbanisés », pour l’essentiel – évoluant dans une précarité qui affecte non seulement leur statut professionnel mais plus généralement tout leur mode de vie. Il est assez remarquable que ce soit un monde presque exclusivement masculin, les quelques femmes mises en scène se limitant aux rôles d’hôtesses ou de prostituées.
« L’HOBOHEME »
Nels raconte dans sa biographie comment sa connaissance du mode de vie hobo et de ses rites lui permet de recueillir des confidences ou des comptes-rendus factuels qui n’auraient pas été révélés à un autre enquêteur. Son apport est donc exceptionnel.
L’expression « observation participante » lui était inconnue : « Si j’ai fidèlement suivi cette méthode tout au long de mon travail, ce n’est pas au sens où l’on entend ordinairement l’expression. Je ne suis pas descendu dans la fosse pour y jouer un rôle puis en remonter en ayant bien soin de brosser la poussière. J’étais alors en train de sortir du monde des hobos. Pour utiliser une expression hobo, préparer ce livre fut un mode de « débrouille », une façon de gagner ma vie au moment où je faisais ma sortie ».
Cette enquête d’Anderson, associant observations et entretiens, détaille les valeurs et les formes d’organisation des hobos – particulièrement au sein du quartier de Chicago où ils se concentrent alors, significativement surnommé la « Hobohème » . L’auteur décrit les lieux d’asile : hôtels et asiles de nuit rudimentaires, cantines de fortune, boutiques de fripes et lieux de divertissement bon marché.
Mais son propos essentiel est de démontrer qu’être hobo représente plus qu’une condition : c’est une véritable culture au sens sociologique du terme, c’est-à-dire un ensemble de normes et de valeurs qui se cristallisent dans un vocabulaire particulier et une intense vie intellectuelle. On y fait la connaissance des orateurs de carrefour avec leur « caisse à savon » sur laquelle ils se juchent pour haranguer les passants et de l’« Université hobo », créée par le philanthrope James E. How, millionnaire « converti » à leur cause. L’université hobo est une sorte de forum public destiné aux loisirs et aux intérêts culturels des habitants de la Hobohême, où se tiennent débats et conférences dont les orateurs sont souvent eux-mêmes des « intellectuels hobos » .
Sont présentés également sa littérature composée surtout d’ouvrages socialistes ou libertaires et son imaginaire incarné dans des chansons et poèmes invoquant divers mythes de la « route ».
Anderson décrit le code moral implicite qui régit cet univers, les « lois de la jungle », comme il les baptise, ainsi que la « débrouille » qu’il considère comme un art, l’état sanitaire, la sexualité, le rapport au politique ou les diverses raisons qui ont pu mener à ce mode de vie, le tout sans céder ni au misérabilisme, ni au populisme. Il ne cache pas les contradictions qui agitent ce milieu hétérogène. Analysant par exemple les échecs récurrents des hobos à s’organiser collectivement, il n’hésite pas à pointer l’égocentrisme et la méfiance de ces derniers en dépit de l’idéal de coopération qu’ils affichent.
Malgré son apparent détachement et le recul nécessaire à un véritable travail d’ethnographie, il est indéniable qu’Anderson n’échappe pas à une certaine volonté de réhabilitation du hobo, qu’il affectionne avec sincérité. Cette fraîcheur d’esprit et la vivacité de l’écriture ne sont pas les moindres des atouts du livre.
LA POSTERITE
Le hobo est devenu une figure mythique de l'imaginaire américain. Perçu comme un personnage teinté d’un romantisme issu du « Wanderlust » allemand, il est épris de liberté. Il refuse de subir les contraintes d'une société aliénante et s’attache à développer la faculté de survivre à l’écart. Cette vision a permis à certains sociologues de le rattacher à une sous-culture libertaire.
La place accordée au hobo dans la littérature, de Jack London à Jack Kerouac (1922-1969)(« Sur la route » en 1957) et dans la chanson folk, souligne également son impact culturel.
Depuis la fin de la « frontière », devant les avancées des machines agricoles, de l'automatisation et du déplacement automobile, la figure du hobo, travailleur manuel libre et itinérant, est toujours donnée comme en voie de disparition. Pourtant la fascination qu'il exerce sur l'imagination est telle qu’elle persiste et se renouvelle au gré des besoins de main-d'œuvre temporaire.
Soixante ans plus tard, en 1982, Douglas Harper publie « Good Company » sur les hobos des années 1970, les « tramps », dont il a partagé la vie pendant une année. Comme l’a fait Anderson pour les hobos, il souligne le « savoir-faire » qu’exige l'usage clandestin des trains et des gares de triage et le « savoir-être » que nécessitent les rencontres au cours des voyages.